
Jean-François DAGUZAN
Vice-président
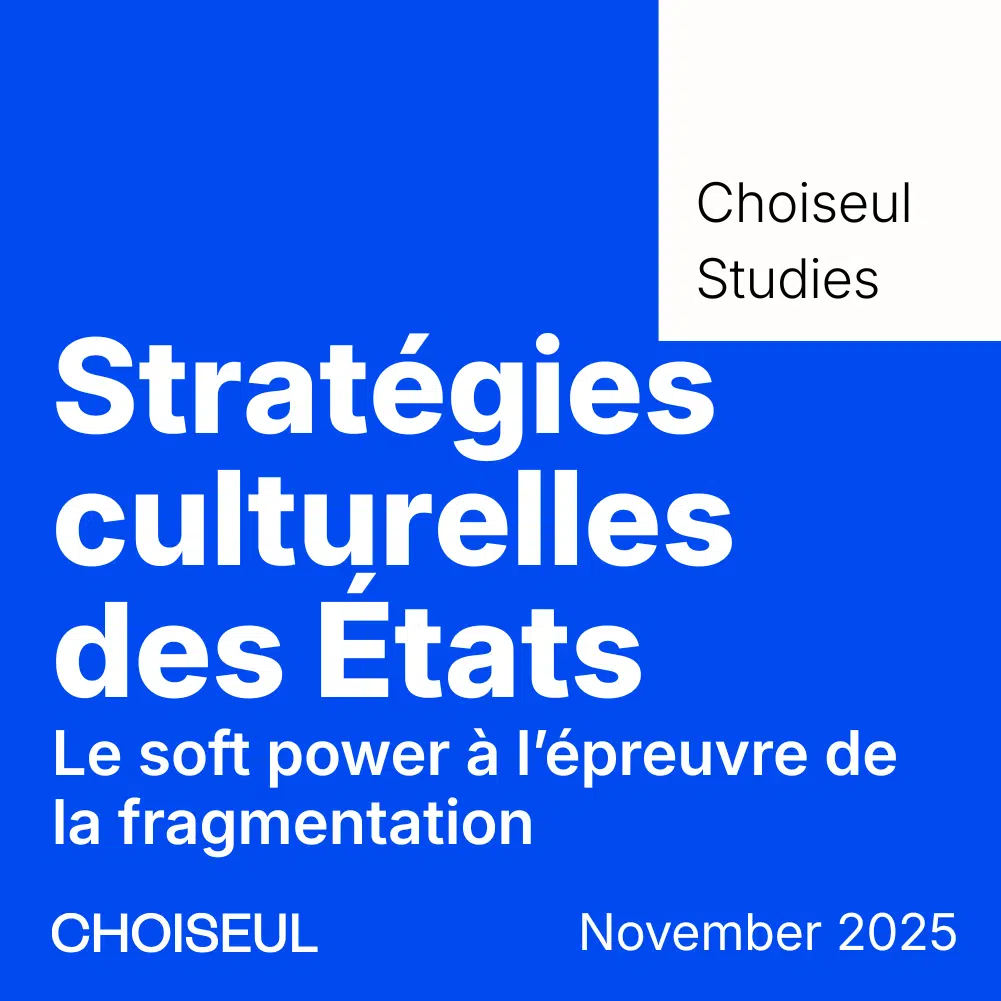
Dans une nouvelle étude, Jean-François Daguzan, Vice-président de l’Institut Choiseul et spécialiste des questions stratégiques, propose une relecture contemporaine des stratégies d’influence culturelle. Il y analyse les mutations profondes d’un concept longtemps stabilisé — le soft power — à travers les stratégies adoptées par plusieurs pays : États-Unis, Corée du Sud, Algérie et Inde.
À l’heure où les réseaux sociaux, les logiques émotionnelles et les tensions géopolitiques redessinent les dynamiques d’influence, la notion d’attraction culturelle retrouve une actualité particulière.
Le monde n’est plus structuré par un seul modèle ; il est traversé par des récits antagonistes, des identités mouvantes et des stratégies hybrides qui mêlent culture, géoéconomie et technologie.
Dans quelle mesure les États-Unis, longtemps archétype du soft power, connaissent-ils une transformation interne de leurs ressorts d’influence ?
Entre polarisation politique, réseaux sociaux mobilisés à grande échelle et continuité d’un écosystème culturel globalisé, la puissance d’attraction américaine demeure, mais sous des formes plus conflictuelles et moins linéaires. Ce n’est plus un modèle uniforme : c’est un champ de forces concurrentes qui s’exportent malgré elles.
Place à l’exemple sud-coréen, devenu en deux décennies l’un des dispositifs les plus structurés du soft power contemporain. Musique, cinéma, séries, mode, jeux vidéo : la Hallyu forme un écosystème cohérent, soutenu par des politiques publiques, un tissu industriel puissant et une mobilisation internationale des communautés.
Le rayonnement culturel sud-coréen s’affirme comme un vecteur d’identité autant qu’un moteur économique.
Un autre modèle se dessine dans le cas algérien, où la dimension culturelle s’inscrit dans une logique plus réactive.
L’étude décrit un usage intensif des réseaux sociaux, une forte charge émotionnelle et une mobilisation de symboles nationaux qui servent de relais aux dynamiques politiques. Il s’agit d’un soft power hybride, davantage situé dans l’espace de l’influence informationnelle que dans celui des industries créatives.
Enfin, l’analyse du cas indien montre une articulation entre puissance créative – Bollywood, contenus numériques, diaspora – et affirmation identitaire. Le pays combine promotion internationale, positionnement civilisationnel et volonté de projeter un récit national cohérent.
Cette hybridation nourrit un soft power à la fois attractif, stratégique et traversé par des tensions internes.
À travers ces trajectoires, l’étude souligne la montée en puissance de stratégies culturelles qui s’inscrivent désormais dans un environnement fragmenté, saturé de signaux faibles et animé par des acteurs publics comme non étatiques. La culture devient un terrain de compétition autant qu’un vecteur d’identité, révélant la manière dont chaque État s’adapte aux formes contemporaines de l’influence.
Elle invite ainsi à repenser les politiques d’action culturelle, à comprendre l’importance des récits nationaux dans la puissance, et à envisager de nouvelles capacités de réponse, notamment en Europe, face à l’intensification des dynamiques d’influence numérique et émotionnelle.
Retrouvez les personnalités qui ont participé à la réalisation de cette publication