
Jérôme BODIN
Analyste Media et Co-Deputy de la Recherche, ODDO BHF
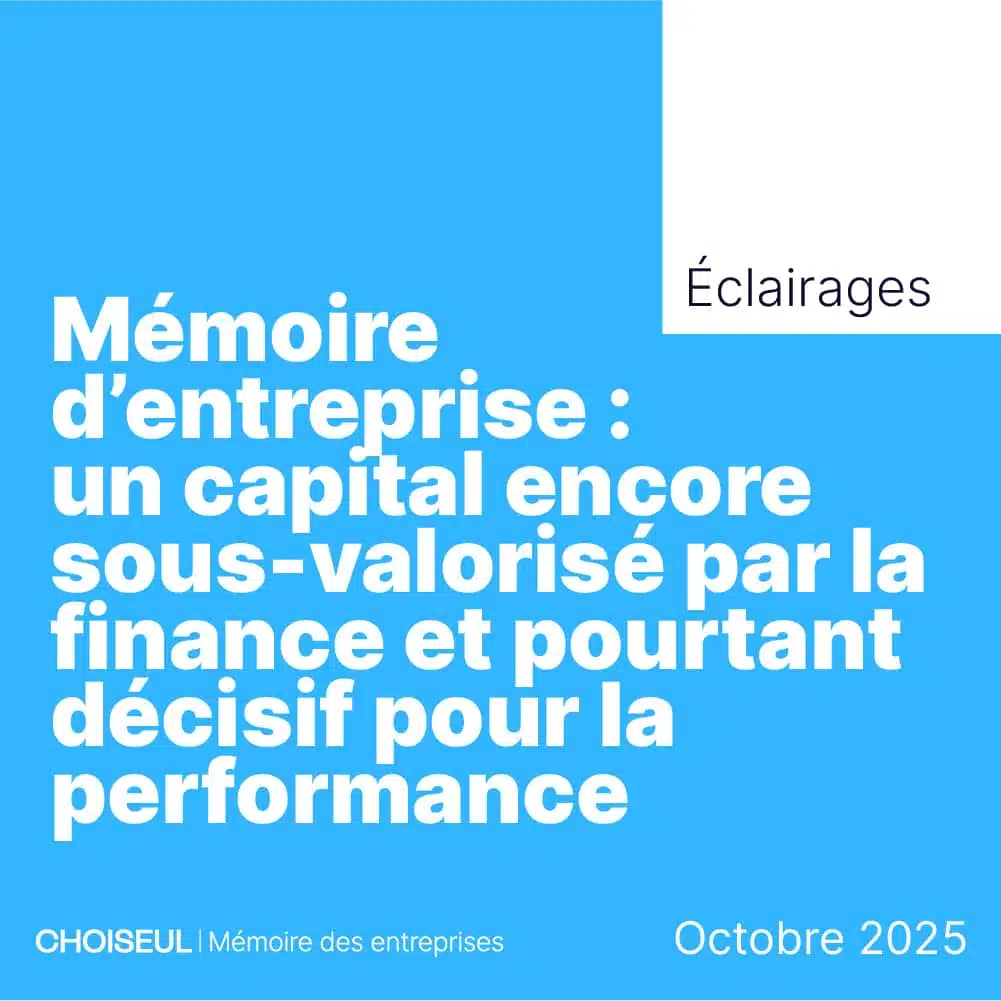
Dans une nouvelle publication réalisée avec l’Observatoire B2V des Mémoires et avec le soutien d’Eurogroup Consulting, nous explorons le rôle souvent sous-estimé de la mémoire dans la valorisation et la transmission d’entreprises.
Les modèles financiers traditionnels privilégient la projection : on valorise l’avenir plus que l’histoire. Multiples, EBITDA « normatifs », comparables sectoriels… L’attention se porte sur la rentabilité future, rarement sur la continuité du passé.
Pourtant, la performance réelle s’ancre dans la durée : fidélité clients, stabilité des équipes, solidité du carnet de commandes, ou encore capacité à surmonter les chocs. Autant d’éléments mémoriels qui irriguent la résilience d’une entreprise sans figurer dans les lignes d’un tableur.
La mémoire ne s’oppose pas à la finance : elle la complète. Elle représente un actif invisible, fait de preuves tangibles — récurrence des revenus, fidélité des clients, engagement des collaborateurs — qui témoignent de la solidité d’un modèle dans le temps.
Les investisseurs le savent : une entreprise capable de démontrer sa continuité inspire confiance. À l’inverse, une mémoire concentrée sur un seul dirigeant, ou insuffisamment formalisée, fragilise la transmission. Le risque n’est pas seulement opérationnel : il touche à la pérennité même de la valeur créée.
Les PME et ETI en particulier, fortement enracinées dans les territoires, portent souvent un capital relationnel et culturel accumulé sur des décennies. L’enjeu n’est donc pas de conserver cette mémoire telle quelle, mais de la documenter, diffuser et mobiliser dans la durée.
Cettepublication propose une grille simple pour évaluer la place de la mémoire dans la valeur d’entreprise :
À la croisée de ces deux axes se distinguent quatre profils d’entreprises : des plus fragiles (mémoire faible et peu formalisée) aux plus solides (mémoire profonde et bien instituée), ces dernières bénéficiant d’une véritable prime de confiance sur le marché.
La mémoire ne doit pas devenir un frein au changement. Elle n’est pas nostalgie, mais ressource stratégique.
Dans un contexte de transmission massive — près de 500 000 entreprises concernées dans les dix prochaines années —, elle constitue un repère précieux pour piloter la continuité, sécuriser les revenus et accompagner les transformations.
Valoriser la mémoire, c’est finalement donner une profondeur au futur : faire de l’histoire vécue une preuve de la capacité à durer.
Retrouvez les personnalités qui ont participé à la réalisation de cette publication